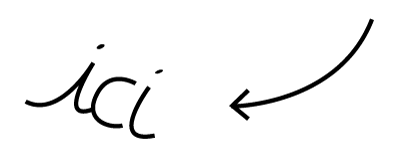Papier personnel
publié le 01/02/2017
Le temps presse
Théâtre
2666
De Julien Gosselin
Le 15 janvier 2017
A la MC2
La pression exercée n'est pas colossale. C'est une question de quelques kilogrammes. Trente, quarante peut-être, cependant elle est pugnace et s'imprime sur les tissus. Lentement les vaisseaux se dilatent et irriguent davantage la zone comprimée. Malgré les mouvements rares, renouvelant épisodiquement l'afflux sanguin, la résorption n'advient pas. Une chaleur commence à se diffuser, ponctuellement accompagnée de picotements. Les liquides stagnent de plus en plus, comme un étang se remplirait. L'eau, le sang, et d'autre peut-être se glissent entre les tissus, les fibres se mettent à gonfler, inhabituellement. La rougeur alors ne part plus à la pression des doigts. Bien qu'encore discret, on parle déjà d'un œdème. Nous sommes au premier stade de l'escarre.
Il faut huit heures trente de théâtre pour en arriver-là, onze et demie en tout si l'on compte le temps pour se restaurer, respirer, ressasser. Telle était l'expérience ces samedi 14 et dimanche 15 janvier à la MC2, avec 2666 le monumental spectacle du petit monstre de la scène, Julien Gosselin. Après le retentissant succès des Particules Elémentaires, où pendant quatre heures déjà il réfractait le roman de Michel Houellebecq, le metteur en scène, fougueux de ses 29 ans, s'est attaqué à plus grand avec le roman, que l'on dit, monde, de Roberto Bolaño.
Une épopée littéraire
L'auteur chilien dépeint en cinq parties une fresque intercontinentale, cherchant à cerner l'origine de l'horreur, le mal du siècle. A cheval entre une Europe vaniteuse se baignant dans l'art et l'intellectualisme comme dans une piscine de champagne et une Amérique pragmatique et inhumaine où se règlent toutes les factures d'une économie anthropophage, l'on suit le parcours d'un groupe de personnages, gouttes d'eau de ce fleuve et reflet d'un monde à la dérive.
Sans en dénaturer la substance, le jeune metteur en scène retransmet avec fidélité le roman, son style, sa structure, sa longueur. Alors, si la maestria de Gosselin réussit le pari, en effet avec aisance et esthétisme il porte les mille trois cents pages sur les planches, l'on se demande l'objectif. La transposition n'enrichit pas davantage l'œuvre originale. D'autant plus, l'adaptation du scénographe laisse une place prépondérante à la littérature : les tirades sont des morceaux de textes, de longs passages sont laissés à la lecture, aussi bien au soin des acteurs que des spectateurs, les dialoguent citent et ne restructurent pas ; oubliant par moment que le théâtre est un genre d'action.
De beaux moyens pour l'événement
En revanche la mise en scène séduit et permet au spectateur de tenir le choc, même si le découpage de deux heures maximum par partie n'y est pas pour rien non plus. Pour supporter tout le poids de l'œuvre Julien Gosselin emploie des moyens en conséquence : la musique, gonflée de basses à faire vibrer les fauteuils, est jouée en live, de nombreux techniciens assurent la danse des grands blocs mobiles formant les décors ou les séries de performance filmique, des artifices scéniques entre cubes de verre et machine à fumée réinvente la perspective et la hauteur entièrement utilisée fore l'espace jusqu'au vertige.
Avouons tout de même que sur l'ensemble de la représentation, ces jeux de scène finissent par être redondants, malgré l'effort de changement de registre d'une partie à l'autre. En plus, quelques détail brisent la vraisemblance et le tissu théâtral : un mug en carton réutilisé, alors inadéquat dans un appartement lounge, une discothèque déchaînée sans clients, un bar où l'on se sert soi-même, des monologues criées sans raison, qui de intenses deviennent surprenants puis étranges… La tension vacille à l'irruption de ce comique impromptu.
Evidemment la performance reste admirable. On peut discuter de la pertinence de la longueur, entre effet d'appel et héritage artistique, néanmoins réussir à maintenir une salle comble pendant onze heures d'affilée relève de la prouesse, démontrant ici un savoir-faire exceptionnel.
Alors que je ne cessais de m'amuser des douleurs causées par une position assise prolongée imposée par un tel spectacle, une amie me rétorquait : « Une pièce de onze heures ? Il n'y a plus de limite à l'égo… » La susceptibilité dépassée, sa remarque me fit réfléchir.
L'art ne répond d'aucune règle. La prouesse pourrait aussi bien résider dans la capacité à faire tenir un roman monde dans une pièce de quatre heures (horaires déjà respectables !) tout comme celle de proposer une représentation non-stop de vingt heures : temps de lecture d'un roman de mille trois cents pages. Alors où se place la limite ? Peut-être dans le respect de la cible, en proposant une œuvre adaptée. Sommes-nous prêts à tout accepté pour l'art ?
N'y a-t-il pas une expérience égocentrique, un despotisme artistique, culte du chef/culte de l'œuvre dans la tentative de canaliser la concentration d'un maximum de personnes sur un maximum de temps ? Une compétition bêtement virile où on se demande, messieurs, qui a la plus grosse ? Représentation évidemment.
T. COPIN